ce texte est aussi sur mon Substack (abonne-toi ici)

Comme beaucoup d’enfants nés fille, j’ai joué à la poupée. Dans ma collection de jouets, il y avait des Barbie grandes minces et bien maquillées. Mais aussi, et avant tout, des poupées bébé, blondes, roses et potelées. Celles à qui on donne le biberon quand elles font un bruit de pleurs, qui viennent avec une poussette, ou des couches à changer. Comme beaucoup petites filles, j’ai joué à la maman, avant même de savoir ce que ça voulait dire vraiment. Bien avant d’être en âge de procréer, je me suis questionnée sur combien d’enfants je voudrais, et comment j’aimerais les appeler. Et puis j’ai grandi, et j’ai arrêté de jouer à la poupée.
De l’adolescence à la vingtaine, le rapport à la maternité fut inexistant. Pour moi et mes copines, tomber enceinte était la crainte ultime. En ce qui me concerne, c’était la pire chose qui pouvait m’arriver. Une grossesse, ça voulait dire la fin de mes études, la fin de ma jeunesse, de ma liberté, la fin des fêtes, des coups d’un soir, de l’alcool et des sorties. Bref, la fin de ma vie tout court. Alors on faisait le nécessaire – ou en tout cas la plupart du temps. On comptait les jours du cycle. On avait le préservatif à portée de portefeuille ou de table de chevet. On prenait des pilules contraceptives – les régulières en tablette, ou celle du lendemain quand on avait déconné, et qu’il fallait se traîner, honteuse, jusqu’à la pharmacie. Des années de rappels sur le téléphone pour ne pas oublier d’avaler une fois par jour ce fichu comprimé. Avec les changements physiques et hormonaux que ça impliquait : boutons, gonflements, sécheresse vaginale. Mais c’était le prix à payer. Avec un peu de chance et plus ou moins de parcimonie, j’ai fait partie de celles qui n’ont pas eu à traverser une procédure d’IVG. A cet âge-là, les grossesses dans mon entourage étaient exceptionnelles, incongrues. Des anomalies de parcours. Hormis une ou deux vagues amies d’amies, on évoluait dans un environnement 100% childfree – un mot qui commençait à devenir à la mode à cette époque, autour de 2010. En opposition à childless qui impliquait un manque douloureux, ce terme soulignait la liberté de ne pas enfanter. On est encore des enfants nous-mêmes, je me disais. On a des études à finir, un job à trouver, des voyages à faire. On a encore un chemin à se frayer vers l’âge adulte, et découvrir ce qu’on veut devenir. On a tout le temps de se décider.
Ma mère avait 31 ans quand je suis née, à la fin des années 80. C’était « tard », statistiquement. Au cours du 20ème siècle, l’âge moyen des mères lors de leur premier enfant a reculé constamment. En 1974 en France, la moyenne était de 24 ans. En 2015, c’était passé à 28. En 2023, 29 ans. De mon côté la trentaine a consolidé mon (non) rapport à la maternité. J’ai troqué la pilule hormonale pour le stérilet en métal. Lentement mais sûrement, je construisais une vie professionnelle dans laquelle je m’épanouissais. J’étais en voyage un mois sur deux, pour le travail ou pour le plaisir. Mon cercle social était densément peuplé – des groupes solides d’ami-es fidèles, des collègues, des connaissances, quelques amoureux et amant-es plus ou moins réguliers. Là encore, un enfant aurait tout ruiné. Je ne me sentais nullement disposée à changer mon mode de vie, fait de nuits enfumées et de grasses matinées. Je sélectionnais mes partenaires sur base de ce critère : si tu envisages un mariage et une descendance, oublie-moi. J’avais adopté un chat, un désir de longue date – et c’était très bien comme ça.
Pourquoi ce refus obstiné ? Pourquoi ce rejet si farouche ? A quoi cherchais-je à échapper ? Je pense que quelque chose en moi considérait le fait de devenir mère comme un compromis, une façon de rentrer dans le rang, de me plier à ce qu’on attend de moi. Un sacrifice injuste de mes propres ambitions et envies. Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai jamais eu envie d’apprendre à cuisiner non plus, c’est peut-être lié. En tout cas je n’ai jamais ressenti ce qu’on appelle « la fibre maternelle ». Je ne me sentais tout simplement pas concernée.
J’ai pendant des années cultivé cette image de sorcière nullipare, au fur et à mesure que la parole des femmes sans enfants progressait dans l’espace public : je me retrouvais dans les écrits de Mona Chollet, les déclarations de Kim Cattrall, de Betty White et bien d’autres, ou encore le compte Instagram @jeneveuxpasdenfant de Bettina Zourli. Je n’ai pas le livre sous la main donc ma référence sera approximative, mais j’ai lu dans Masculin Féminin de Françoise Héritier que certaines sociétés anciennes considéraient les femmes nullipares comme « immatures » : des femmes qui étaient restées enfant, et qui en conséquence étaient enterrées à part du reste de la tribu. Je me souviens avoir lu ce passage avec un certain amusement. J’assumais pleinement mon immaturité, au vu de ce à quoi être un adulte ressemblait.
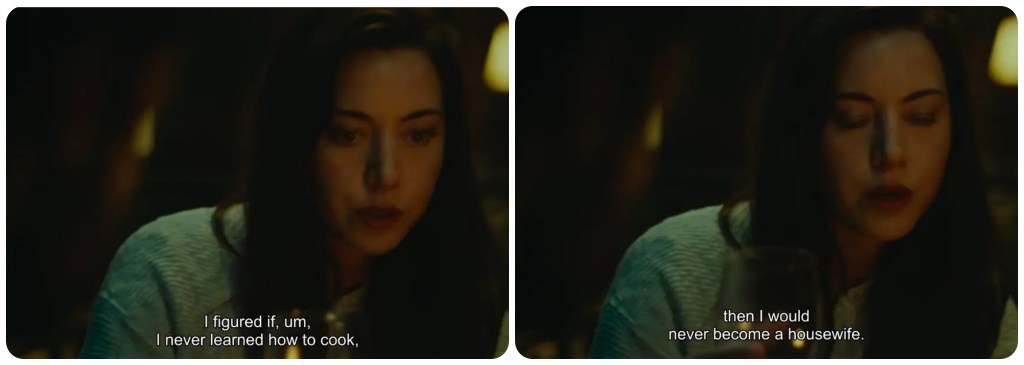
L’intime e(s)t le politique
Désirer un enfant est-il quelque chose d’inné, ou de construit ? Est-ce que c’est inscrit dans nos gènes, est-ce que c’est la nature humaine, ou est-ce que parce qu’on est élevés avec l’idée que c’est ce qui est prévu et doit arriver ? Est-ce un mélange des deux ? De manière similaire, ne pas ressentir ce désir est-il naturel, ou culturel ? Est-ce que certaines personnes naissent naturellement sans cette envie, est-ce purement une conséquence du contexte sociopolitique ? Ou les deux s’alimentent-ils mutuellement ?
Tandis qu’autour de moi commençaient à surgir les premières annonces de grossesses désirées, plus j’avançais dans la trentaine, moins enfanter faisait sens. Plus j’en apprenais sur le fonctionnement du monde, plus ma conscience politique s’aiguisait, plus cette pensée s’est radicalisée. Aux raisons personnelles et intimes, se sont ajoutées des raisons politiques, écologiques, structurelles. Comme des couches qui se superposent au fil du temps – et qui sont, en un sens, toutes liées.
Je me disais, enfanter sous le capitalisme, non merci. Pas dans cette société, dans ce qu’on en a fait, où le soin compte moins que la consommation, où il faut « gagner » sa vie pour exister, où la biodiversité recule, que les glaciers fondent, et qu’on parle à moitié en plaisantant de la fin du monde. En ce sens, je voyais aussi dans le fait de garder mon ventre vide comme un refus d’alimenter ce système carnassier, en y jetant en pâture encore un enfant qui n’aurait rien demandé. A choisir, ça me semblait plus cohérent de dédier une partie de mon temps et de mon énergie à lutter contre ce système, comme je le pouvais. En manif, par la plume, par l’action, dans des camps de réfugiés…
(Au fond, je pense qu’une source de mon activisme vient du fait que je ne décolère pas d’avoir appris en grandissant que tous les humains ne sont pas égaux en vrai, et tous les enfants n’ont pas l’occasion de jouer à la poupée.« The children are always ours » comme dit James Baldwin : d’Athènes au Soudan, de Bruxelles à Gaza, pas besoin d’avoir enfanté pour sentir son cœur qui se déchire face à un enfant blessé.)
Ensuite, au fur et à mesure qu’une partie de mon entourage franchissait le cap de la parentalité, j’ai aussi constaté concrètement la charge mentale, financière, physique et émotionnelle que ce choix entraînait. J’ai vu mes amis galérer – enfin, surtout mes amies. Entre le cops qui change, les hormones, les aléas de santé imprévus, la violence que peut avoir le système hospitalier, le post-partum. Entre l’angoisse de perdre son job, les horaires impossibles, les coûts insensés. La crèche, le pédiatre, la bouffe, les jouets. J’ai vu des copines malmenées, tristes et épuisées par cette nouvelle vie. J’ai vu leur frustration même avec, et malgré, des partenaires pleins de bonne volonté (alors j’imagine même pas sans ça). J’ai mieux compris à travers leurs récits la dimension genrée de la parentalité. Ça a contribué à défaire les mythes sur cette expérience, censée être l’accomplissement de mon existence. Des trottoirs publics aux congés parentaux inégaux en passant par mille autres aspects, j’ai vu comment notre société méprise et isole les mères. Et comment j’ai pu moi-même y contribuer. J’avoue que pendant longtemps j’ai pu regarder avec incompréhension et jugement les femmes qui faisaient ce choix si diamétralement opposé au mien. Que ce soit dans un film ou dans la vraie vie, j’étais celle qui, à l’annonce d’une grossesse ou à la vue d’une poussette, levait les yeux au ciel. « Au secours, pas les mioches ». Dans les transports, dans la rue, dans l’avion, j’évitais les enfants autant que je le pouvais. Les seuls qui m’émouvaient occasionnellement, c’était ceux que je voyais au cinéma, parce que je m’identifiais. Avec le temps, j’ai compris que ce mépris est politique aussi. J’ai appris à déconstruire cette misogynie intériorisée et à dissocier mes choix personnels de la lutte collective.
Mais derrière ces grands discours abstraits, je pense que si j’avais vraiment ressenti ce désir, j’aurais, comme nombre de personnes avant moi, cherché des façons de concilier la maternité avec mes convictions. « It takes a village » dit le dicton, et en effet, si je vivais dans ce village… Je l’aurais peut-être fait. Dans une autre vie, une autre société, moins cruelle, plus égalitaire et solidaire, je pense que j’aurais pu être mère. Dans un autre contexte, ça aurait fait sens, peut-être.
Parce que bien sûr au-delà des récits horrifiques, j’ai vu et je vois la joie, l’émerveillement, l’amour infini, et le sens que l’enfant peut apporter à une vie. Et peut-être encore plus aujourd’hui.

Quelqu’un a dit un jour dans un film en Arabe : « Qui donne la vie ne meurt jamais. »
Nullipare et nulle part
2025 s’achève et ma trentaine aussi, dans un monde désolant et désolé. On n’aura pas autant lu et prononcé les mots pandémie, génocide, fascisme, que ces 5 dernières années.
Aujourd’hui parmi les gens de ma génération, ne pas faire d’enfant n’est plus une exception. Comme Bettina Zourli l’explique dans son livre, beaucoup partagent mes doutes et inquiétudes sur l’état du monde, l’instabilité financière, la foi en l’avenir, et la capacité de se projeter. Dans mon cercle social, je dirais que c’est fifty-fifty. Je connais autant de gens qui ont un voire deux enfants, que de gens nullipares – par choix ou encore indécis – avec qui c’est possible de boire un verre improvisé à 21h un mardi. A défaut de bébé, beaucoup ont opté pour un animal de compagnie.
De mon côté, après l’insouciance et la légèreté de la vingtaine, et les désillusions et avancées de la trentaine, l’approche de la quarantaine m’amène, presque malgré moi, à faire une sorte de bilan. Ces derniers temps, je traverse une phase fébrile de ma vie, à mon corps défendant : je suis assaillie de questionnements qui n’étaient pas là avant, je doute beaucoup, je me remets en question énormément. Je réfléchis au sens de ma vie. Et pour la première fois je crois, je me surprends à penser à l’après. Qu’adviendra-t-il de mes affaires, de ma maison, des souvenirs de ma vie ? Qu’est-ce que j’ai à transmettre, et à qui ? Est-ce que j’ai mal choisi ? Merde, is this la crise de la quarantaine ? Est-ce que j’ai simplement trop de temps libre, et faire des gosses m’aurait évité ces angoisses existentielles – ou même pas ?
Avec tout ça, il se passe un truc étrange. Je ne pense plus systématiquement à changer de trottoir quand je croise des enfants en rue. Qui l’eut cru. Peut-être c’est l’âge, qui fait que je m’attendris – ou la fameuse horloge biologique, légende urbaine ou vrai phénomène (?), qui se réveille même si on ne lui a pas sonné. Pourtant je n’ai toujours pas trouvé le courage, l’entourage, la conviction et le budget. M’embarquer pour 20 ans de rentrées scolaires et de repas à préparer me semble une épreuve pour laquelle je ne suis pas taillée. J’arrive à peine à me nourrir moi-même correctement trois fois par jour – immature forever, comme dans le livre de Françoise Héritier. Mais ces tergiversations existentielles m’amènent à voir différemment le pourquoi du comment. Je comprends mieux, je crois, cette envie aujourd’hui. Je conçois autrement la tendresse, l’émerveillement, l’attachement. J’entrevois l’émotion et l’excitation de (re)découvrir le monde comme si c’était la première fois à travers ces yeux-là. L’envie de transmission, de partage. D’amour au-delà du romantique, au-delà de soi, le décentrage que ça implique. Je conçois mieux la douceur de voir un petit être grandir, et celle d’une joue rebondie, d’un câlin, d’un rire.
Je vois aussi comment faire des enfants est une façon de transcender notre inévitable mortalité. Ou de tromper l’ennui et la peur de la solitude, aussi ?
(Parfois je ressens un pincement à cet endroit quand je pense à mes parents. Pardon papa pardon maman, de ne pas vous avoir donné la joie d’avoir des petits-enfants. Désolée de ne pas continuer la lignée. C’est une étrange tristesse, difficile à articuler. Une déception par procuration, alors que mes parents ne m’ont pourtant pas particulièrement mis la pression. « Je ne regrette pas de vous avoir eus, mais bien sûr, c’était dur. Fais ce qui te rend heureuse, et je serai heureuse pour toi » m’a dit ma mère une fois quand je lui en ai parlé. Je crois que ça m’a fait du bien de l’entendre. Que ça m’a consolée.)

Les enfants des autres
Tandis que 2025 s’achève et que ma trentaine aussi, je pense à ces groupes d’amis fidèles et soudés de la vingtaine. Je pense aussi à comment le choix ou non de la parentalité a affecté nos relations.
Si le non-désir d’enfants était évident pour moi, c’était tout aussi évident que j’aim(er)ais les enfants des personnes mon entourage. J’ai souvent déclaré que « j’aime pas les enfants – sauf ceux de mes amis ». A défaut de les comprendre, j’étais contente pour eux, si c’était leur choix, et qu’ils en étaient heureux. Mais je savais que ça voulait dire que nos chemins allaient très probablement s’éloigner. A quelques exceptions près, la plupart ont traversé ou traversent la fameuse « disparition » sociale qui vient avec l’arrivée d’un nouveau-né. D’un côté, quoi de plus normal : une nouvelle existence exige l’omniprésence. Les priorités et les rythmes de vie changent. On a beau mettre en place toutes les initiatives et garde-fous du monde, parfois on ne peut que compatir de loin, en voyant certains se faire rouler dessus par le bulldozer de la parentalité. De l’autre je me demande comment nous en sommes venus à considérer cette « disparition » comme une inévitable fatalité. Depuis que le village est devenu une grande ville, élever un enfant n’est plus une expérience collective. Les parents se retrouvent souvent seuls face à ce nouveau défi. Encore plus quand les grands-parents ou la famille étendue ne sont pas toujours à portée, que toute aide professionnelle coûte cher… Alors que le besoin de communauté est plus fort que jamais, comment faire village, dans une société qui nous isole ? Comment garder le lien avec mes amis durant cette merveilleuse et éprouvante aventure ? Comment composer avec cette nouvelle réalité ? J’admets que j’ai pu avoir un rapport compliqué avec ce rebattage des cartes de l’amitié. Je me suis demandé quelle était ma place là-dedans, et s’il y en avait une tout court. Dois-je mettre les bouchées doubles, essayer d’être présente autant que possible ? Est-ce bienveillant et bienvenu ou déplacé et incongru ? Dois-je me mettre en retrait ? Est-ce que mon meilleur acte d’amitié est tout simplement de leur foutre la paix ?
Bien sûr, chaque cas est différent. Et chaque cas l’a été. Parfois l’équilibre est venu naturellement dans notre relation. Parfois ça a été plus compliqué. Parfois j’ai pris mes distances, plus ou moins consciemment, dans un mélange de frustration et de culpabilité. Frustration de voir l’amitié se déliter, et culpabilité de me sentir frustrée. J’admets non sans honte que j’en ai parfois voulu à mes amis d’avoir disparu. Tout en me disant que je suis une mauvaise amie, une connasse égocentrée. Comment ai-je le culot d’attendre quoi que ce soit. Je dois juste lâcher prise, retourner à ma vie, et on se retrouvera un jour, naturellement – quand la progéniture ira à l’université. Ou pas, et c’est la vie ma chérie.
Je me demande si c’est une conséquence normale des aléas que l’âge adulte entraîne naturellement. On a grandi, on s’est éloignés, géographiquement, humainement, ou les deux. On a d’autres priorités, des métiers prenants, un quotidien chargé. C’est comme ça. N’empêche que cette absence me taraude parfois. Je me demande s’il n’est peut-être pas trop tard pour trouver des façons de reconstruire, même un peu, ce foutu village perdu. Je sais que je ne suis ni Mary Poppins ni la baby-sitter idéale. Cependant j’ai à cœur de trouver des façons d’être présente – là où c’est possible. En balade, aux anniversaires, en vacances. J’ai noté, pour la plupart, leur date de naissance. Je me demande à quoi ils ressemblent, comment ils grandissent. Est-ce qu’il est encore possible d’être la tata, la marraine, ou la copine de maman et papa, celle souvent en voyage mais toujours de passage, qui leur amène des bonbons et joue avec eux à cache-cache. Celle qui pourra les emmener plus tard en manif et au ciné. Venir à l’école, faire des goûters, des balades, parler de la vie, conseiller, échanger des secrets. Je me dis aujourd’hui que je suis heureuse et chanceuse d’avoir quand même autour de moi des personnes qui ont l’envie d’amener des enfants dans ce monde. Je les admire d’autant plus d’avoir le courage de le faire dans ce monde-là.
Je continue de réfléchir à tout ça. Finalement, je crois que la maternité peut exister autrement – en tout cas les notions de transmission, d’amour, de soin, qu’elle sous-entend. C’est de plus en plus difficile d’avoir la foi qu’un avenir meilleur viendra, mais je continue d’essayer, parce qu’on sait jamais. Je vais encore en manif. Je porte toujours un stérilet. Je teste des nouvelles recettes de temps en temps. Je ne dis plus « j’aime pas les enfants ». Je me couche et je me lève à pas d’heure. Je fume toujours, mais moins qu’avant. J’envisage dans quelques années d’adopter – un chien. Bientôt 40 ans, et les choses n’ont presque pas changé.

(Parfois, en toute humilité, je me dis que ce que je laisserai, ce seront des mots sur du papier – réel ou virtuel. Des carnets intimes, des coupures de journaux, des critiques cinéma, des écrits personnels. Des dizaines de textes courts et peut-être quelques romans. Peut-être que si que je recueille les histoires de ma famille, que j’enregistre ma mère, ma grand-mère, mon père, que je ressens le besoin de garder une trace de leurs vies, c’est parce que je sais qu’il n’y aura personne d’autre pour le faire après moi. Si je sens une urgence intérieure, c’est celle de trouver une façon de donner vie à ces mots, en faire des récits. J’y passerai sans doute le reste de ma vie. C’est ma façon de transmettre quelque chose, de la seule façon dont je sais faire. Tant que j’aligne des mots, je ne suis pas complètement foutue. Je crois qu’écrire est la seule façon que j’ai trouvée de ne pas mourir.)
En savoir plus sur Elli Mastorou
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.


f6f7f7; »> Bonjour, Merci pour ces émotions, Hélas mon message est trop court pour vos évocations. Si je pense, un exemple fameux entre millions, à Simone de Beauvoir qui n’eut de pseudo continuité d’elle-même, eh bien ses enfants de sa pensée la comblerent, voir en exemple « Tout les hommes sont mortels ». Ma fille à un fils… comme pour des millions de « vieux » ils sont des étrangers au plan « attente éphémère du retour du « sang » », sauf si « sonnant et trébuchant » se manifeste… Nous courrons tous vers une certaine, certaine fin des temps. Que regretter ? De n’avoir pas conçu de morts en court surcis sur un cailloux habité par des fous (sinon ils ne pourraient vivre tant c’est absolument suffocant ici très bas, en raison) qui tourne avec le reste. Ah vous les femmes, surtout, et nous les hommes, qu’avons nous fait pour subir cette patholie d’angoisse du vide de néants, quand sans postérité condamnée avant d’être. Ce mot « nullipart » est un néologisme du démon, qui est et que vous ne voulez considérer, vous réjouissant inconsciemment de ses quasi néologismes bien criminels. Oui dans quelques temps, car leur ballades terrestres sont plus courtes que les nôtres, un animal fidèle émotif. Je douis stopper mes nerfs… Bon courage « dans l » azur ». Francis Gardon, l’ancien, qui ne se relit, souvent en Grèce, vers Oropos.
<
J’aimeJ’aime
Chouette article…Bonne année…quand mème…restons positif et vigilant…à bientôt… Baci Freddy __
FREDDY BOZZO Program Director / Vice-president Brussels International Fantastic Film Festival – BIFFF 35TH EDITION: 4 – 16 APRIL 2017 FREDDY@BIFFF.NET http://WWW.BIFFF.NET [http://www.bifff.net/]
rue de la Comtesse de Flandre 8 Gravin van Vlaanderenstraat B – 1020 Brussels, Belgium T : +32-(0)2-201.17.13 [tel:%2B32-%280%292-201.17.13] F : +32-(0)2-201.14.69 [tel:%2B32-%280%292-201.14.69] Join BIFFF on Facebook !
Le dimanche 4 janvier 2026 à 23:29, Elli Mastorou
J’aimeJ’aime